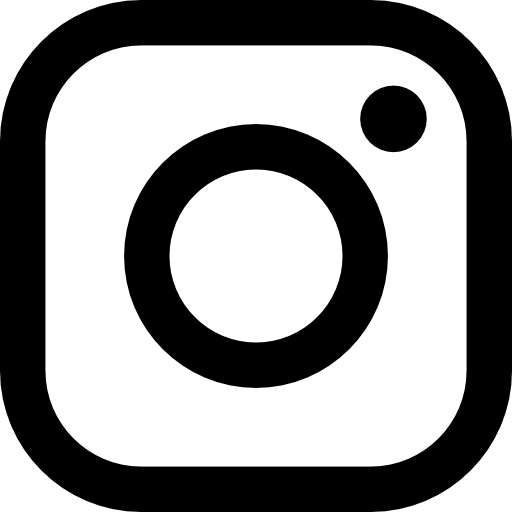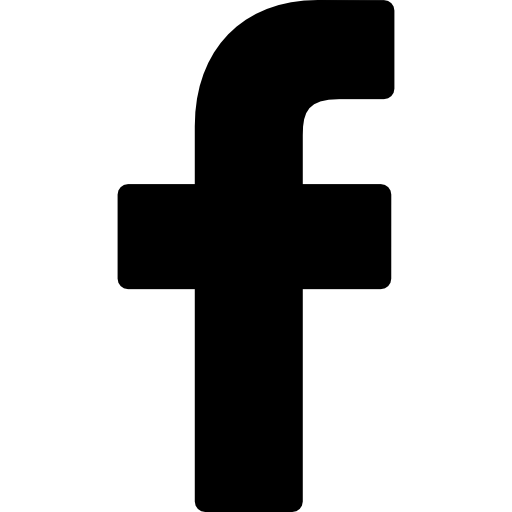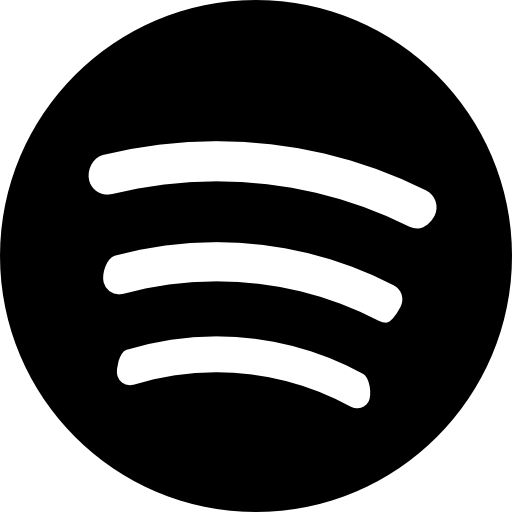REGINA DEMINA
L’alliance du feu et de la glace, du morbide et de la candeur, de la culture pop et de l’underground punk. En Regina Demina, artiste aux multifacettes, à la fois performeuse, actrice, danseuse et désormais chanteuse, vibrent des univers qu’on pensait, à première vue, irréconciliables : la Russie et la banlieue parisienne, la pole dance et l’art contemporain, les icônes religieuses orthodoxes et Mylène Farmer magazine, « Ondine » de Jean Giraudoux et Nabila. Un fourre-tout culturel qui aboutit sous nos yeux (et surtout à nos oreilles) à un petit miracle. Son premier album, « Hystérie », remarquable de cohérence et d’homogénéité, s’écoute avec la sensation d’avoir découvert un trésor oublié sous une pierre. Outsider de l’industrie musicale, l’auteure-compositrice-interprète se paie même le luxe de nous offrir deux ou trois tubes en puissance (« Couzin », « Nabila », « L’homme jasmin ») que des paroles à la fois naïves et pleines de sous-entendus, et une techno-house-pop cousue main signée Sam Tiba, Jérôme Blackjoy Caron, Contrefaçon ou Marc Collin rendent indispensables à tout amateur éclairé de plaisirs cultes.
A l’instar de sa musique, le C.V. de cette héroïne franco-russe aux faux airs de Carolyn Bessette-Kennedy mauvais genre se boit comme un shot de vodka : cul sec. Naissance à Kalilingrad, en grande banlieue de Moscou, enfance emmitouflée dans l’ombre de la perestroïka, père scientifique militaire travaillant pour le Kremlin, mère professeure de piano. Puis le départ, à l’âge de quatre ans, pour la France et ses foyers de migrants, avant de connaître Champs-sur-Marne, ses parcs et ses étangs, son ennui white trash et arboré. A quinze ans, le réel fait irruption avec fracas dans sa jeune vie d’adolescente anorexique : choc allergique, hôpital, expérience de mort imminente, « ambiance « L’Exorciste », résume t-elle avec concision. La fracture est si grande qu’elle provoque un avant et un après dans son existence. A dix-sept ans, la jeune fille quitte alors le domicile familial, vit sa vie pied au plancher, multiplie les aventures artistiques et les petits boulots. Et elle se construit peu à peu, au fil des shootings en tant que mannequin et de la réalisation de courts métrages, une identité créative forte dont le point d’orgue est une installation sonore, « Alma », qui lui vaudra le prix de la révélation Arts Numériques 2016, suivie de performances diverses et de la sortie, dès 2018, de plusieurs singles. Loin de tous diktats et contraintes artistiques, sociaux ou culturels, Regina pratique le déminage à l’envers : en posant ici et là de petites bombes où un certain romantisme macabre (fragments de tombes en marbre, carcasses de voiture sculptées) côtoie un baroque pop jamais dénué d’humour. Et peaufine un personnage sensuel et (bi)sexuel, au narcissime 2.0, entre créature de David Cronenberg (« Crash » ?) pour l’étrangeté fétichiste et proie de David Hamilton pour l’ingénuité mise en scène.
Pourtant, n’en déplaise à la mémoire du prédateur suscité, c’est bien un objet post #MeToo que l’auditeur de cet album tiendra entre ses mains fébriles. A « L’Amour monstre », (titre gainsbourien d’un morceau auquel a collaboré Lësterr), assassin, qui l’aura dévorée pendant toute une année, la chanteuse à la voix fragile et comme distanciée oppose ainsi une poésie-antidote aux tons pastels et un beat électronique glacial et robotique. « Je trouve très courageuses les filles qui balancent sur Twitter, mais moi j’ai peur pour ma sécurité, je préfère sublimer » avoue t-elle. Et c’est bien dans une période émotionnellement chargée, pleine d’ « Hystérie », comme le souligne le titre de l’album, à prendre au premier degré, qu’elle aura terminé cet opus placé sous le signe de cette relation toxique, aussi éprouvante qu’une « commotion cérébrale ». « Cela m’amusait de reprendre ce terme d’hystérie, forcément daté. Je suis souvent hystérique car je ressens les choses intensément. Mais il y a une beauté là-dedans, comme dans le fait de se servir de ce qui pourrait être un handicap pour en faire une source de créativité. »
Ce qui n’empêche pas Regina Demina, toujours mutine, de s’évader, le temps d’un titre électro pop au beat imparable, au refrain entêtant, vers de plaisantes amours qu’on espère incestueuses malgré le « z » trompeur (« Couzin »). Ou d’évoquer, sur le registre du slow sensuellement synthétique, son désir brûlant, à la Violette Leduc, pour « Nabila » et autres icônes de la pop culture, starlettes émouvantes au sex appeal fabriqué de toutes pièces. Il faudrait citer encore, pour rendre justice à un album surprenant du début à la fin, « L’homme jasmin », hommage rêveur à l’écrivaine et plasticienne allemande Unica Zürn qui sombra dans la folie et qui avait, comme les amis défoncés qu’évoque le morceau, des hallucinations ; le kraftwerkien « Mathématiques », éloge en creux aux amours impossibles ; l’asthénique et aérien « Fleur de métal » ; ou encore le technoïde « Ondine mélancolie », furieuse évocation en russe, sa langue natale, de la pièce de Giraudoux et du mythe de la sirène, cher au cœur de l’artiste. « Ce sont des reines dans la mer, mais sur terre, des handicapées. Dans les contes, elles tombent généralement amoureuses d’un type d’un milieu social élevé qu’elles fascinent, mais qui les délaisse toujours au final pour une femme du même milieu que lui. Je ne peux m’empêcher d’y voir une fable sociologique. »
Et nous, un conte cruel qui nous fascine presque autant que Regina Demina, nouvelle reine énigmatique d’un dancefloor contaminé par la mélancolie.